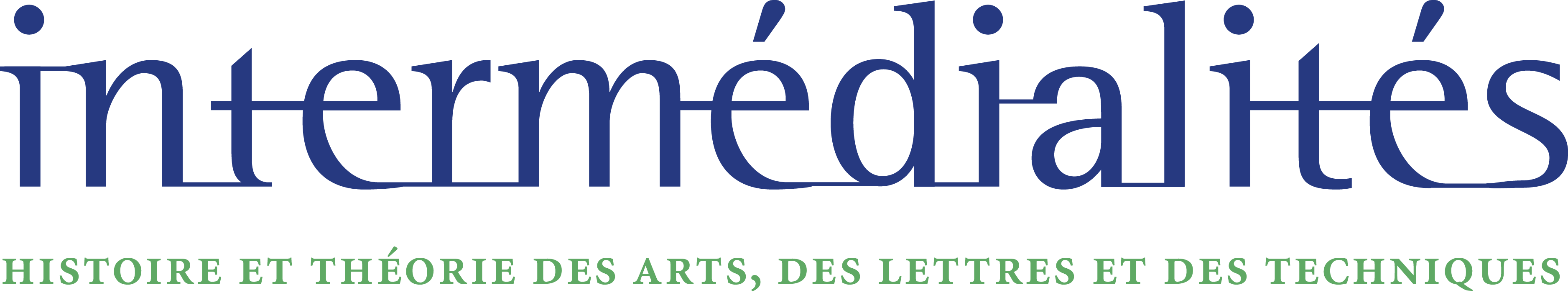Faire l’histoire, faire de l’histoire, c’est d’ordinaire raconter, tirer un fil narratif qui échantillonne et ordonne les possibles. Il est difficile d’échapper à ce moyen de fabriquer le monde qui repose sur une certaine linéarité et met le plus souvent de l’avant les positions de la société qui les reçoit, les idéologies dominantes. C’est néanmoins un modèle alternatif de mise en récit que Bastien Gallet propose d’explorer dans l’article « De quelques figures contemporaines de la “politisation de l’art” » (« remixer », n° 23). Selon Gallet, il est en effet possible de résister à un devenir propagande de l’histoire linéaire, en accordant aux œuvres le pouvoir de monter/prélever/recontextualiser et coaliser le réel. Usant de cette stratégie lui-même dès lors qu’il réfléchit et restructure la pensée de Walter Benjamin portant sur la relation de l’art et du politique[1], Gallet en vient à définir les caractéristiques d’une démarche artistique efficace, dans la mesure où elle réussit à produire des effets politiques.
Ces effets sont pensés à l’intérieur d’un régime non « opéral » — « c’est-à-dire un régime dont l’œuvre n’est pas l’horizon ni l’index de son fonctionnement[2] ». Devant être perçu comme conceptuel plutôt que littéral, le modèle proposé par Gallet mise sur la pratique du montage par lequel « quelque chose du monde fait irruption dans l’œuvre et menace de la faire éclater ». Ce déplacement permet de mettre en exergue des modalités interactionnelles entre l’œuvre et son milieu. Il rend visibles des « problèmes spécifiques et localisés »qui demeureraient autrement cachés.
Cet art révèle sa portée politique dès lors qu’il prélève dans le réel des « pièces rapportées » pour produire des « dispositifs » faits « pour s’adapter à un contexte cognitif cible ». Réinsérés — recontextualisés — dans ces « contextes cognitifs », l’art en tant que dispositif les transforme en fonctionnant. L’œuvre ainsi située devient capable de circonscrire un problème local et d’amener ses récepteurs, ou à tout le moins une partie de ceux-ci, à le surmonter[4]. Ainsi, l’opérativité du dispositif permet à ceux [et celles] qui le souhaitent de se coaliser pour le résoudre, et « invite à la constitution de collectifs, de groupes d’individus réunis par un même objectif.[5] »
Le montage est, dans le texte de Gallet, la pierre angulaire qui permet aux autres registres mentionnés de se produire. Les quatre interventions artistiques qu’il nous présente y font appel de façons différentes et servent à exemplifier divers possibles interactionnels : la note de Joseph Beuys produite lors du Festival der Neuen Kunst de 1964 s’insère dans le réel, recontextualise le mur de Berlin en proposant de le remonter de cinq centimètres ce qui changerait son statut en l’esthétisant, en modifiant le regard que l’on porte sur lui; La fabbrica illuminata de Luigi Nono (1964) prélève des bruits d’une usine et compose à partir d’eux en les mélangeant à un chœur et à la voix d’une soliste, rendant sensible, à travers l’écrasement des voix par les bruits de l’usine, les conditions de travail des ouvriers ; dans Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971, Hans Haacke enquête sur les agissements douteux de l’investisseur immobilier Harry Shapolsky et les documente pour les mettre en lumière; Times Square de Max Neuhaus, installée en 1977 et interrompue de 1992 à 2002, implante à Times Square un son supplémentaire et discret qui ressemble à ceux déjà produits par les villes normales. Il utilise ainsi les éléments sonores du lieu pour suspendre l’écoute « intéressée, ciblée, stratégique, indicielle » qu’on en fait ordinairement.
Les dispositifs que nous propose Gallet datent des années 1960 et 1970. Ils tentent de résoudre des problèmes qui appartiennent aux domaines de l’économie politique (Haacke et Nono) et de l’occupation des lieux (Beuys et Neuhaus). Or, dans le contexte actuel où l’art politique relève plutôt de revendications identitaires, d’autres pratiques de montage semblent se manifester. Ainsi, Bushra Junaid, dans Sweet Childhood (fig. 1), créée en 2017, amalgame des médiums /réitère un discours. De fait, le dispositif souligne que les corps noirs ont historiquement fait l’objet d’une réification. Ils ont été considérés à la fois comme des fétiches et des objets rendant possibles des échanges marchands en transformant des matières premières pour en faire des biens de consommation et ce, sans en tirer profit eux-mêmes.

Fig. 1 : Sweet Childhood, Bushra Junaid, 2017, Archival photograph and archival text printed on backlit fabric panel.

Fig. 2 : Sweet Childhood, Bushra Junaid, 2017, Archival photograph and archival text printed on backlit fabric panel.
Créée au cours d’une démarche ayant mené à l’exposition Here We Are Here: Black Canadian Contemporary Art / Nous sommes ici, d’ici : L’art contemporain des Noirs canadiens[6], le dispositif de Junaid s’accapare d’abord une forme médiatique démodée hautement impérialiste qui réduit l’autre à une chose manipulable, consommable et reproductible : les vues stéréoscopiques. Ces vues sont connotées. Elles ont été conçues pour donner l’illusion d’un environnement immersif tridimensionnel où les regardeurs blancs des classes moyennes pouvaient alors accéder à des ailleurs lointains et dépaysant tout en gardant le contrôle sur leur expérience. L’expérience qui est proposée dans la vue stéréoscopique qu’a choisie Junaid est une mise en contact avec les corps d’enfants noirs dans une plantation de canne à sucre. L’image a été produite en 1903 par une compagnie qui détient à ce moment le monopole sur le médium, la Keystone View Company.
Ce que dit déjà l’image est réitérée par l’artiste qui y amalgame des petites annonces tirées du St. John’s Evening. Ces publicités servent de corps aux enfants et s’entremêlent aux cannes à sucre. Le texte qui y est inscrit fait allusion au commerce effectué par Terre-Neuve avec plusieurs entreprises qui exploitaient des esclaves dans les Caraïbes, lieu d’origine de l’artiste, durant une partie considérable du 20e siècle. Junaid met en scène des corps assujettis, de par la nature même du médium d’origine, dont la valeur marchande est soulignée par les extraits de journaux. Les corps noirs sont ainsi assimilés à des objets observables, sans agentivité, soumis aux regards d’un sujet blanc.
Qui plus est, en utilisant des médiums qui sont à la fois des pièces reproductibles et des archives, Junaid insiste également sur la vaste diffusion de ces images et de ces textes, bien qu’ils soient ignorés par l’histoire officielle. L’œuvre sert donc de révélateur pour le récepteur en réitérant un contenu (caché) : celui de l’exploitation d’un groupe racialisé qui a été repoussé aux franges de l’histoire canadienne. En somme, le dispositif réfléchit à l’échec d’un récit nationaliste qui ne fait pas de place aux relations que le Canada a entretenues avec l’esclavage et ne se soucie guère de la représentation marchande des corps noirs.
Enfin, soulignons que cette mise en lumière du problème intègre subtilement le musée dans sa critique. Le contexte cognitif n’est pas neutre et se joue à travers l’œuvre. Here We Are Here: Black Canadian Contemporary Art / Nous sommes ici, d’ici : L’art contemporain des Noirs canadiens est la première exposition présentée par le Royal Ontario Museum sur la communauté noire depuis Into the Heart of Africa tenue en 1989/1990[7]. Into the Heart of Africa se voulait une analyse critique du rôle exercé par le colonialisme canadien et européendans la constitution des collections africaines du ROM. D’abord encensée par la critique, l’exposition a ensuite été décriée pour son contenu stéréotypé, la nostalgie perçue du colonialisme qu’elle mettait en place et son insensibilité culturelle[8]. Sweet Childhood fait précisément retour sur ces problèmes et ce, d’autant plus que la période couverte par le dispositif correspond au moment de la fondation du musée.
Reste maintenant à découvrir si le problème soulevé par l’œuvre à un moment où les revendications identitaires des communautés noires, notamment à travers le mouvement Black Lives Matter, saura provoquer des actions à l’intérieur et en dehors de son institution d’accueil. À tout le moins, son analyse démontre que la pratique du montage, telle qu’elle est proposée par Gallet, peut être élargie et s’appliquer à des dispositifs qui voient actuellement le jour.
Marjolaine Poirier (UQÀM)
*********
Bastien Gallet, « De quelques figures contemporaines de la « politisation de l’art », Intermédialités, nº 23, « Remixer », printemps 2014, https://www.erudit.org/fr/revues/im/2014-n23-im02092/1033337ar/
Here We Are Here: Black Canadian Contemporary Art / Nous sommes ici, d’ici : L’art contemporain des Noirs canadiens, Royal Ontario Museum, Toronto, 27 janvier au 22 avril 2018, https://www.rom.on.ca/en/exhibitions-galleries/exhibitions/here-we-are-here-black-canadian-contemporary-art
*********
[1] Par. 16 : c’est selon l’auteur ce que nous lègue Benjamin, soit la nécessité de penser un art « sans œuvres ».
[2] Par. 2.
[3] Par. 44.
[4] Cet argument s’appuie sur les trois composantes du dispositif que décline Christophe Hanna : « l’hétérogénéité interactionnelle », « la contextualité » et « l’opérativité ». Nos dispositifs poétiques, Paris, Questions théoriques, 2010, p. 14-18.
[5] Par. 44.
[6] Exposition présentée du 27 janvier au 22 avril 2018 au Royal Ontario Museum.
[7] Exposition présentée de novembre 1989 à août 1990 au Royal Ontario Museum. Le musée a présenté des excuses officielles en 2016 : https://globalnews.ca/news/3058929/royal-ontario-museum-apologizes-for-1989-into-the-heart-of-africa-exhibit/ (consultation 1er mars 2018).
[8] Shelley. R. Butler, Contested representations: Revisiting « Into the heart of Africa », Amsterdam, Gordon & Breach, 2013, p. 41-79.