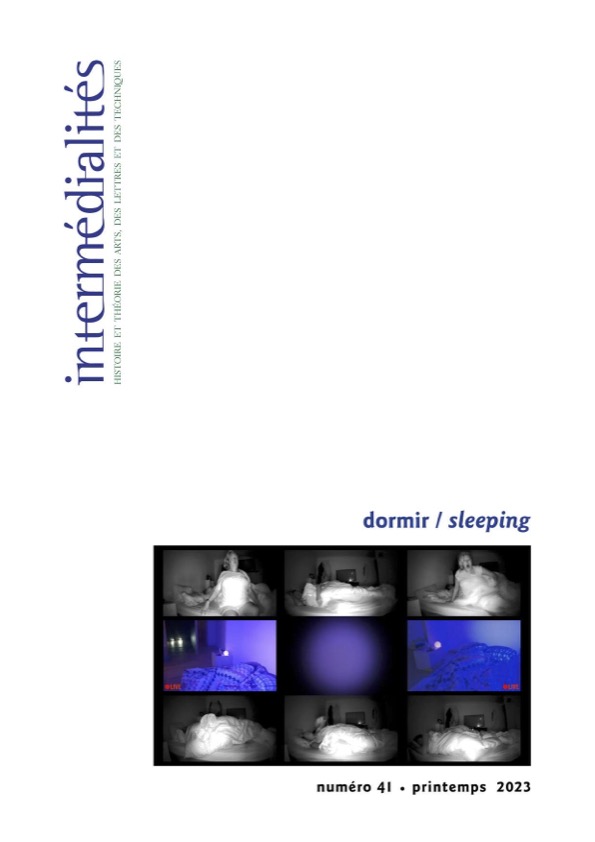Numéro 41, Printemps 2023
Sous la direction de Aleksandra Kaminska, Dayna McLeod et Alanna Thain
En quoi le sommeil est-il un phénomène médiatisé et médiateur ? Quand et comment le sommeil devient-il enregistré et connaissable, partageable et communicable, par et entre les corps, les personnes, les médias, et entre notre propre moi endormi et éveillé ? De quelle manière sommes-nous ensemble dans le sommeil ? Comment nous connaissons-nous et prenons-nous soin de nous-mêmes et des autres en tant que dormeurs ? Si le sommeil peut être social, comment devons-nous modifier ou élargir notre sens du social lui-même ? Ce numéro spécial d’Intermédialités / Intermediality sur “Dormir / Sleeping” s’interroge sur la manière dont les formes et les pratiques (inter)médiatiques sont essentielles pour repenser le sommeil à notre époque agitée.
Grâce à des approches sociales, expérientielles, expérimentales et critiques des médiations du sommeil à travers les modes de vie queer, racialisés, genrés et de classe, les articles de ce numéro mettent en scène des rencontres avec le sommeil à travers des formes médiatiques qui élargissent nos sensibilités somatiques partagées. En particulier, une attention renouvelée aux inégalités du sommeil qui résultent du corps qui travaille, nous amène à nous demander : quels types de travail inconscient médiatisent le sommeil et comment ce travail est-il invisibilisé, manifesté, déraillé, célébré, et/ou compliqué ? Si le sommeil se déplace, s’attarde et s’étend dans les seuils critiques de la conscience, c’est aussi entre le public et le privé, l’individuel et le collectif, le corps et l’environnement, la matière et l’esprit qui contribuent à faire du sommeil un site de vulnérabilité radicale et de risque social d’une manière exigeant des formes de soins, y compris des soins pour les imaginaires collectifs du sommeil. Les médias ont joué un rôle essentiel dans la représentation du sommeil, mais aussi dans l’animation des défis qu’il pose à la capture et à l’affichage. Les articles de ce numéro s’appuient sur une multiplicité de médias et de disciplines pour créer des conversations entre les formes et les pratiques qui remettent en question et élargissent les méthodologies et les épistémologies de la connaissance du sommeil, dans le but de mieux prendre en compte l’hétérogénéité du sommeil.